 |
| La Lanterne de Diogène. Montpellier, 1917. Le curé, le juge, l'étudiant, le soldat, le bourgeois |
1917 La Lanterne de Diogène
Voici une revue dont la teneur littéraire nous laisse un peu sur notre faim. Il est vrai qu'elle est, vers la fin de la guerre de 1914, toute rédigée par des très jeunes hommes (je n'y croise aucune femme), qui ont entre 17 et 19 ans. Étudiants, nous les verrons partir un à un pour rejoindre l'armée, puis le front. Presque tous récidiveront dans d'autres revues. Nous y voyons surtout la première apparition publique d'un nommé Jean MOULIN, "futur sous-préfet" de 20 ans. Mais aussi de Maurice Chauvet ou de Jean Claparède.
Dates : Le n°1 porte la date du 9 décembre 1917. Le dernier numéro conservé et sans doute paru est le n°45, de juin 1920. (Une collection incomplète aux AD de l'Hérault, cote PAR694).
1917 La Lanterne de Diogène
Voici une revue dont la teneur littéraire nous laisse un peu sur notre faim. Il est vrai qu'elle est, vers la fin de la guerre de 1914, toute rédigée par des très jeunes hommes (je n'y croise aucune femme), qui ont entre 17 et 19 ans. Étudiants, nous les verrons partir un à un pour rejoindre l'armée, puis le front. Presque tous récidiveront dans d'autres revues. Nous y voyons surtout la première apparition publique d'un nommé Jean MOULIN, "futur sous-préfet" de 20 ans. Mais aussi de Maurice Chauvet ou de Jean Claparède.
Voici une revue dont la teneur littéraire nous laisse un peu sur notre faim. Il est vrai qu'elle est, vers la fin de la guerre de 1914, toute rédigée par des très jeunes hommes (je n'y croise aucune femme), qui ont entre 17 et 19 ans. Étudiants, nous les verrons partir un à un pour rejoindre l'armée, puis le front. Presque tous récidiveront dans d'autres revues. Nous y voyons surtout la première apparition publique d'un nommé Jean MOULIN, "futur sous-préfet" de 20 ans. Mais aussi de Maurice Chauvet ou de Jean Claparède.
Dates : Le n°1 porte la date du 9 décembre 1917. Le dernier numéro conservé et sans doute paru est le n°45, de juin 1920. (Une collection incomplète aux AD de l'Hérault, cote PAR694).
Dates : Le n°1 porte la date du 9 décembre 1917. Le dernier numéro conservé et sans doute paru est le n°45, de juin 1920. (Une collection incomplète aux AD de l'Hérault, cote PAR694).
Tonalité donnée par le premier édito :
Nous sommes un journal d’étudiants. Nos collaborateurs sont les uns mobilisés, les autres sur le point de l’être... Nous ne parlons pas de la guerre, et c’est par pudeur... Ce que nous voulons, c’est conserver les vieilles traditions écolières, traditions de rire franc et de saine gaîté.
Collaborateurs :
L’étude de la revue est rendue très difficile par l’absence de textes réellement littéraires, et par l’emploi de pseudonymes impénétrables.
Un des plus drôles est Le Moustique Victorieux, traduisez Victor Cousin, qui signe, entre autres, un portrait charge en Méphistophélès du conservateur de toutes les bibliothèques de Montpellier, Henri Bel.
Diogène, titre de la revue, est aussi la signature de nombreux textes. C'est le pseudonyme de Paul Arnaud (qui le dévoile lorsqu'il part à l'armée le 14 avril 1918 et dont nous parlerons plus longuement à propos de L'Âne d'or), mais c'est aussi peut-être un pseudonyme collectif.
Jean Claparède qui signe parfois Saliceti de Saliceto donne son nom à quelques “définitions” humoristiques... Mais qui est Le Scribe qui écrit le 28 avril 1918 un article sur Frédéric Bazille? Est-ce un autre pseudonyme de Jean Claparède qui, devenu conservateur du Musée Fabre, organisera la rétrospective du peintre chez Wildeinstein en 1950?
Un des plus drôles est Le Moustique Victorieux, traduisez Victor Cousin, qui signe, entre autres, un portrait charge en Méphistophélès du conservateur de toutes les bibliothèques de Montpellier, Henri Bel.
Diogène, titre de la revue, est aussi la signature de nombreux textes. C'est le pseudonyme de Paul Arnaud (qui le dévoile lorsqu'il part à l'armée le 14 avril 1918 et dont nous parlerons plus longuement à propos de L'Âne d'or), mais c'est aussi peut-être un pseudonyme collectif.
 |
| Paul ARNAUD, fondateur de la Lanterne de Diogène, mort avocat à 24 ans |
Jean Claparède qui signe parfois Saliceti de Saliceto donne son nom à quelques “définitions” humoristiques... Mais qui est Le Scribe qui écrit le 28 avril 1918 un article sur Frédéric Bazille? Est-ce un autre pseudonyme de Jean Claparède qui, devenu conservateur du Musée Fabre, organisera la rétrospective du peintre chez Wildeinstein en 1950?
Certains caractères se devinent, souvent à des indices ténus. Par exemple, au concours du “plus beau garçon de Montpellier” Raymond Ott est classé premier, et Maurice Chauvet recueille 5 voix. La Lanterne en tire gloire : ce sont ses collaborateurs...
Maurice Chauvet, qui tiendra tant de place vers le milieu du siècle à Montpellier, publie le 13 juin 1920 des vers "dignes de Valéry Larbaud". La comparaison n'est pas neutre. En 1957, à la mort de Larbaud, Chauvet adressera, de sa propre initiative, un télégramme de condoléance au nom de la ville de Montpellier, qui avait oublié que Larbaud avait tant, et si bien, parlé d'elle.
Pierre Tisset part pour la Sorbonne en novembre 1919. Il y enseignera. Mais il revient régulièrement comme comédien amateur, ou comme couturier à Montpellier en 1920. C'est là qu'il mourra en 1968, professeur de droit féru de Jeanne d'Arc.
Un certain Joseph Aldémar qui publie, en vers (?), chez Fasquelle Les Grands hommes de la France, quitte la revue, où il signait Rat-dit-Noir en juin 1920. Mais, devenu Jean RYS, il sera une des stars de la TSF à Montpellier pendant l'entre-deux guerres.
Johannes Ahenobarbe est un certain Jean Caffort dont je ne sais rien. Notons quand même qu'un Charles Caffort est alors député radical socialiste de l'Hérault, ami du père de Jean Moulin et qu'en novembre 1919, un compte rendu du Congrès Radical socialiste paraît sous la plume de "M" (Antoine-Èmile Moulin? ).
Maurice Chauvet, qui tiendra tant de place vers le milieu du siècle à Montpellier, publie le 13 juin 1920 des vers "dignes de Valéry Larbaud". La comparaison n'est pas neutre. En 1957, à la mort de Larbaud, Chauvet adressera, de sa propre initiative, un télégramme de condoléance au nom de la ville de Montpellier, qui avait oublié que Larbaud avait tant, et si bien, parlé d'elle.
Pierre Tisset part pour la Sorbonne en novembre 1919. Il y enseignera. Mais il revient régulièrement comme comédien amateur, ou comme couturier à Montpellier en 1920. C'est là qu'il mourra en 1968, professeur de droit féru de Jeanne d'Arc.
Un certain Joseph Aldémar qui publie, en vers (?), chez Fasquelle Les Grands hommes de la France, quitte la revue, où il signait Rat-dit-Noir en juin 1920. Mais, devenu Jean RYS, il sera une des stars de la TSF à Montpellier pendant l'entre-deux guerres.
Johannes Ahenobarbe est un certain Jean Caffort dont je ne sais rien. Notons quand même qu'un Charles Caffort est alors député radical socialiste de l'Hérault, ami du père de Jean Moulin et qu'en novembre 1919, un compte rendu du Congrès Radical socialiste paraît sous la plume de "M" (Antoine-Èmile Moulin? ).
Jean Lacoste se cache, lui, sous le pseudonyme de Chrysostome.
Castagné signe Nicole.
Mais comment signent Emile Carbon (qui devient en février 18 "cymbalier de la musique du 81e" régiment d'infanterie), André Lignères ou Eugène Causse, tous membres fondateurs? Si nous pouvons être certains de la participation de quelques collaborateurs à la revue, il est souvent impossible d’attribuer à chacun son œuvre.
Quelle est la contribution de Eugène
Causse, Léon Arribat, Raymond Ott, Maurice Chauvet, Emile Carbon,
Raymond Delmas, ou de
Jean Milhau qui n'est pas certainement pas qu'un excellent illustrateur ?
Qui rédige le 23 juin 1918 une Histoire des cafés de Montpellier (illustré par Ch. Hamonet)?
Et qui sont : Colibri, Le Frileux, Bout de Zan, Pion-Pion, Pétrarque
le Consul, Gaspard de la Nuit, Plum, Flic, Margaritas Anteporcos, Taxys?
Les pastiches sont la spécialité de Paul ARNAUD (mais je pense qu'il n'est pas le seul à pratiquer La manière de...) :
Rétrospectivement, le plus remarquable est la présence de Jean MOULIN. La donation de Laure Moulin au Musée de Béziers comprend de nombreux dessins (caricatures) et quelques unes des revues dans lesquelles elles ont paru. Lors de l’exposition du centenaire de Jean MOULIN en été 1999, un exemplaire de La Lanterne de Diogène était exposé, ouvert sur un dessin signé JM. Car Jean Moulin dessine. N'oublions pas qu'il signera plus tard Romanin des dessins dans de nombreux journaux.
Nous apprenons le 28 avril 1918 que "Moulin, futur sous-préfet, complète actuellement ses connaissances administratives au 2e génie, aux côtés de Georges Curbelier, le célèbre dandy ... et de Paul Arnaud".
Le 25 décembre 1919, un dessin de Jean Moulin (signé JM) représente un fiancé entrant dans la chambre un bouquet à la main. Un crucifix est au chevet du lit, un tableau au mur. Légende : Ah ! Perfide, me tromper le lendemain de nos fiançailles! Vous pouviez bien attendre que nous soyons mariés pour faire ça!
Nous apprenons le 28 avril 1918 que "Moulin, futur sous-préfet, complète actuellement ses connaissances administratives au 2e génie, aux côtés de Georges Curbelier, le célèbre dandy ... et de Paul Arnaud".
Le 25 décembre 1919, un dessin de Jean Moulin (signé JM) représente un fiancé entrant dans la chambre un bouquet à la main. Un crucifix est au chevet du lit, un tableau au mur. Légende : Ah ! Perfide, me tromper le lendemain de nos fiançailles! Vous pouviez bien attendre que nous soyons mariés pour faire ça!
Ce n'est certes pas là que le génie de Jean Moulin éclate. Ces dessins sont soit un apprentissage, soit des péchés de jeunesse...
D'ailleurs, André DUPIN semble le dessinateur attitré de la revue :
Le numéro de Pâques 1919 offre une lithographie hors texte de Dupin montrant une place de la Comédie rendue cosmopolite par ses soldats américains :
À Noël de la même année, un numéro exceptionnel sera un feu d'artifice.
Maurice Chauvet inaugure sa littérature régionaliste avec une Ballade clapassière signée Paul Fort.
Une chronique brillante et malheureusement non signée s'enthousiasme pour Marcel Proust dont les livres "après quatre mille ans qu'il y a des hommes qui pensent apportent du nouveau ... Point de drame, d'intrigue ou de catastrophe... ". Une telle critique, en 1919, c'est un bonheur pour Montpellier !
En résumé,
La Lanterne de Diogène est exactement à mi-chemin entre L’Effort des Jeunes et L’Ane d’Or. Nous parlerons de ces deux revues.
Du premier, on retrouve le côté étudiant, voire lycéen. De L’Effort viennent Emile Carbon, Raymond Delmas, André Dupin, Raymond Ott, Jean Claparède, bien d’autres sans doute non identifiés, et aussi Eugène Causse, le seul peut-être à avoir participé aux trois revues.
La Lanterne fournira, elle, à L’Âne d’Or plusieurs de ses fondateurs ou collaborateurs : Paul Arnaud, bien sûr, Maurice Chauvet, Robert Castagné, Jean Milhau... Elle inaugure surtout le goût des pseudonymes grecs et latins, et la passion des pastiches littéraires. Mais ici, ce jeu stérilise toute autre création littéraire, ce qui ne sera pas le cas dans L’Ane d’Or.
En 1922, nos étudiants seront alors un peu sortis du stade potache.
A noter que, aussi bien dans L'Âne d'or que dans le recueil de Mélanges publiés par Henry Cabrillac après la mort de Paul Arnaud en 1924, seule une allusion si voilée qu’elle est incompréhensible rappelle l’existence de La Lanterne de Diogène.
Mais que Maurice Chauvet, dans son discours de réception à l'Académie de Montpellier en 1948 évoque La Lanterne de Diogène et l'Ane d'Or très chaleureusement, mais trop succinctement, hélas.





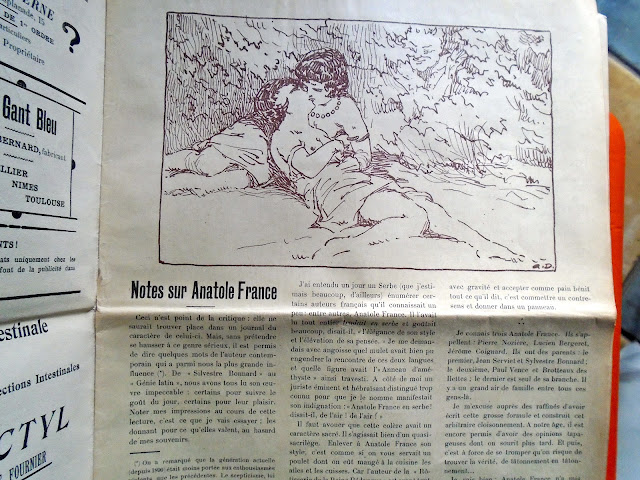






Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire